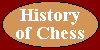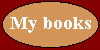Pastoureau's Chess / Pastoral Chess
Les Échecs de Pastoureau / Les Échecs pastoraux
In the original French version of his book, "Une histoire symbolique du Moyen-Âge occidental" published in 2004, Michel Pastoureau, a famous French historian of Middle Age, gave an original account of Chess as it was supposed to be played in this period.
But this description is surprising
because I (the webmaster of this website) never met
anywhere several of the details and rules he reported.
Would it be possible that the great historian have made
some errors?
It remains possible that Michel
Pastoureau did have access to original medieval texts
which bear these elements, but then, I ignore which ones
they are. However, if I strongly doubt that Chess was
really played according to the rules here given (for
readers of French, the original Pastoureau's text is
reproduced at the bottom of this page), the game then
described looks playable.
I suggest to call it Pastoral Chess.

|
I have been
disapointed to see that this same 2004 text that
has been recycled and used again for Michel
Pastoureau's latest book "Le jeu d'échecs médiéval, une
histoire symbolique" (Le Léopard d'Or, 2012),
reproducing the same errors. |
Differences with accepted
medieval Chess rules
|
According to Michel Pastoureau |
What is generally admitted for
|
|
Every player could modify somewhat the rules if his adversary agreed. |
It is true that several manners of play existed (named "assizes") but these depended on the region where the games was played (i.e. France, England, Lombardy, Germany, etc.) and not on the sole wish of the players. |
|
Before the end of the 15th century when the Queen acquired her modern move, the strongest piece was the Alfin (i.e. the Bishop) which could move diagonally as much as it wants. |
Before the end of the 15th century, the strongest piece was the Rook (same move as today). The Alfin/Bishop was very limited (even more limited that the medieval Queen) jumping at a 2nd square diagonally. |
|
From 14th century, several authors limit the move of Bishop to 3 squares. |
A jump to a 2nd square was described as a 3 step move by medieval authors (because they counted the starting square) |
|
The Rook moved horizontally or vertically of 1, 2 or 3 squares only. |
The medieval Rook moved exactly as today, horizontally or vertically on an unlimited number of squares. |
|
From mid-14th century, some Italian authors said that the Rook could move an unlimited number of square. Then the Rook became, instead of the Bishop, the most powerful piece. |
The Rook never changed its move, inherited from Muslim Chess. The Rook was the strongest piece on the Board from the origin until the end of 15th century when the Queen acquired her modern move. |
|
The Knight moved as today, on a 2 squares step, 1 in diagonal and 1 in right angle. |
A curious description of the Knight's move. "Right angle" with what? |
|
The King could move 2, 3 or 4 square in any directions when he stayed in his half of the board, and of 1 square only when he is on the opposite half of the board. |
Except at his first move, the King moves 1 step in all directions. At his first move, the King may jump at any 2nd square, horizontally, vertically, diagonally or like a Knight. |
|
The Pawn moves identically (i.e. 2, 3 or 4 squares) but only straight forward. |
The Pawn moves 1 step ahead without capturing. It captures 1 step diagonally forward. At his first move, the Pawn could advance 2 steps ahead. |
|
When a King is mat, he is shifted one or more squares and the game continues. |
When a King was mat, the game was over. |
|
The winner is not the player who has mated but the player who has played the most beautiful moves. |
The winner was the player who had mated the opposite King. |
It seems that Michel Pastoureau mixed the technical aspects of the game as described in the manuscripts (such as endings, problems, etc.) with some elements that can be found in social works (the "moralities") and epic romances. I am therefore skeptical on taking this rules as genuine, however they could be tried for sake of curiosity.
Original text
in French ![]()
Michel Pastoureau
« Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental »
La Librairie du XXIe siècle, Seuil, Paris 2004.
Extrait
du chapitre « L’arrivée du jeu d’échecs en
Occident »,
pages 289-290 avec notes associées.
Les règles du jeu médiéval sont différentes de celles d'aujourd'hui, mais elles sont aussi et surtout changeantes, chaque joueur ayant, après accord avec son adversaire, la possibilité de les modifier quelque peu. Du moins si l'on en croit la littérature chevaleresque[1].
Au demeurant, comme aujourd'hui, on se vante fréquemment de savoir jouer et de connaître les règles alors qu'on les ignore. Dès le XIIe siècle, jouer aux échecs relève pleinement de la culture courtoise et l'on est fier de montrer que l'on a compétence et talent en ce domaine.
La principale différence avec le jeu moderne réside en ce que la valeur de la reine (l'ancien vizir du jeu indien et arabe) est faible sur l'échiquier: elle ne peut avancer qu'en diagonale et seulement d'une case à la fois. Lorsque, à la fin du XVe siècle, la reine pourra progresser d'autant de cases qu'il lui plaît, et ce aussi bien horizontalement et verticalement qu'en diagonale, elle deviendra la pièce maîtresse du jeu et celui-ci s'en trouvera profondément modifié; les parties seront plus dynamiques et plus riches en retournements de situation.
Jusqu'à cette date, la pièce la plus forte sur l'échiquier est l'alfin (fou ou évêque, ancien éléphant du jeu oriental) qui avance en diagonale d'autant de cases qu'il le veut[2].
Le roc (notre tour actuelle), au contraire, ne peut se déplacer qu'horizontalement ou verticalement et seulement d'une, deux ou trois cases à la fois[3]. Sa force est à peu près égale à celle du cavalier qui comme aujourd'hui se déplace toujours de deux cases en deux cases, l'une en diagonale, l'autre à angle droit.
Quant au roi, il peut avancer dans toutes les directions, de deux, trois ou quatre cases lorsqu'il se trouve dans sa moitié de l'échiquier, d'une seule case lorsqu'il se trouve dans la moitié adverse. Même marche pour le simple pion mais seulement vers l'avant en ligne verticale.
Ces règles expliquent pourquoi les parties sont lentes et peu mouvementées. Elles consistent davantage en une suite de « combats singuliers », pièce contre pièce, qu'en des stratégies de grande envergure, mettant en branle tout l'échiquier. Mais cela ne gêne guère les joueurs de l'époque féodale, habitués aux affrontements de petits groupes, voire au corps à corps, et pour qui l'essentiel n'est pas de gagner mais de jouer. Comme dans d'autres exercices aristocratiques - la chasse par exemple -, le rituel compte plus que le résultat. Au reste, jusqu'à la fin du XIIe siècle, si l'on en croit les textes littéraires, comme dans les guerres féodales, il n'est pas vraiment prévu qu'une partie se termine par la victoire ou par la défaite de l'un des deux camps: lorsqu'un roi se trouve en position de mat, on le déplace d'une ou de plusieurs cases et la partie reprend.
Capturer ou tuer, même symboliquement, le roi adverse aurait quelque chose de vil, de lâche, et même de ridicule. Le vainqueur, si vainqueur il y a, n'est pas celui qui met son adversaire en position de mat mais, comme au tournoi, celui qui a réalisé les plus beaux coups[4].
Ces pratiques, cependant, évoluent dans le courant du XIIIe siècle, comme le montre le volumineux traité compilé vers 1280 à la demande du roi de Castille Alphonse X. Sous l'influence des joueurs musulmans, plus forts que les chrétiens, les parties se font moins longues et, par la position du mat, désignent désormais le vainqueur et le vaincu. La guerre féodale, qui servait de modèle, est désormais loin. À partir des années 1300, des compétitions sont organisées qui mettent aux prises les meilleurs joueurs d'une cour, d'une ville, d'une région, d'abord dans la péninsule Ibérique et en Italie, puis dans toute l'Europe occidentale. Mais jusqu'à la fin du Moyen Âge, les joueurs occidentaux les plus forts restent italiens et espagnols; par la suite ce seront les Portugais[5].
Il existe déjà quelques champions renommés dont, pour le xve siècle, nous avons gardé les noms[6].
Ces champions paraissent avoir de bonne heure préféré la composition de problèmes théoriques aux parties véritables. Plusieurs recueils de ces problèmes nous ont été conservés et témoignent déjà de l'extraordinaire dimension spéculative du jeu. Les fins de partie y retiennent alors toute l'attention, mais pas encore les ouvertures.
[1] W Wackernagel, « Das Schachspiel im Mittelalter », dans Abhandlungen zut deutsche Altertumskunde und Kunstgeschichte, Leipzig, 1872, p.107 127.
[2] À partir du XIVe siècle, plusieurs auteurs limitent à trois cases maximum la marche de l'alfin.
[3] À partir du milieu du XIVe siècle, certains auteurs italiens affirment que le roc peut se déplacer d'autant de cases qu'il lui plaît. II devient ainsi, à la place de l'alfin, la pièce la plus forte.
[4] M. Pastoureau, L'Échiquier de Charlemagne, op. cit., p. 37 39.
[5] Toutefois, jusqu'au XVIIe siècle, chaque fois qu'ils s'affronteront, les joueurs musulmans l'emporteront sur les joueurs chrétiens.
[6] J. M. Mehl, Les jeux au royaume de France, op. cit., p.184 222.